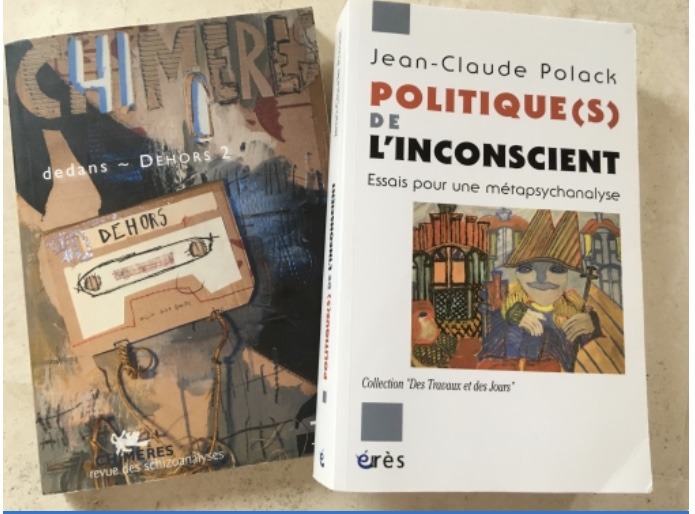Au-delà de l’inconscient Entretien avec Jean-Claude Polack
Par Catherine Murgante
Médecin psychiatre, psychanalyste, Jean-Claude Polack, engagé dans la psychiatrie institutionnelle travaille dès 1964 à la clinique de La Borde, animée par Jean Oury et Félix Guattari. En 1976, il fonde à Paris le groupe du 125, un cabinet de psychiatres et psychanalystes, et une association de patients (Trames). Avec Danièle Sivadon, il met en route la revue Chimères en 1987, créée par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Il publie également des ouvrages où la question de la folie rencontre le politique, l’histoire et le cinéma. Je l’interroge ici sur les liens entre l’art et la folie.
Comment penser le lien entre l’art et le soin ? A la clinique de La Borde où vous exerciez, l’art était très présent.
A La Borde, la question de l’art était riche et complexe. Elle remonte à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban et François Tosquelles, psychiatre communiste condamné à mort par Franco (et Staline…), militant républicain dans la guerre d’Espagne. Pendant l’Occupation, de nombreux résistants, écrivains, artistes et poètes, Paul Eluard, Tristan Tzara,vont se réfugier là-bas ; ils savent que c’est un hôpital où l’on peut se cacher et qui est proche du maquis. Tosquelles réorganise ce lieu géré par des sœurs. Epris d’art, il fabrique et sculpte lui-même des objets. A Saint-Alban, plusieurs patients fabriquaient des œuvres extraordinaires qui sont entrées dans cette classification de l’Art Brut. A La Borde il y eut des gens qui travaillaient sur les œuvres des malades, des poupées, des constructions… On retrouvera des objets faits ou peints par des personnes hospitalisées à La Borde au Musée d’Art brut de Lille.
La Borde a même attiré de nombreux artistes peintres, cinéastes, venus s’installer pour y travailler…
Souvent La Borde a séduit des artistes, au point de les amener à la clinique et d’y séjourner quelques temps. François Millon, par exemple, est venu travailler et vivre à La Borde où il a animé un atelier de peinture avec les patients. Il y a eu aussi René Laloux qui a réalisé un dessin animé Les Dents du Singe (1960) avec les patients.
Nicolas Philibert, documentariste passionné, y a vécu plusieurs mois très près des patients qu’il a filmés dans La Moindre des choses. Je pourrais citer aussi Josephine Guattari et François Pain qui ont filmé Min Tanaka, danseur buto, devant la clinique ; de nombreux malades, envoutés, prennent ensuite la parole et commentent ce moment rare.
De nombreux hôpitaux offrent des médiations artistiques. Puis est arrivé le courant de l’art thérapie … L’art peut-il contribuer à nous soigner ?
Les grands personnages artistiques considérés comme malades et hospitalisés, ont été souvent très isolés. Quelques uns des soignants trouvaient intéressant ce qu’ils créaient, mais personne n’a jamais pensé que ce travail pouvait être utilisé comme soin. Il y avait du respect, de l’intérêt pour ces activités, mais elles n’établissaient pas forcément un lien entre le directeur, les infirmiers et les malades. La célèbre Aloïse, par exemple, hospitalisée en Suisse, dont les tableaux sont aujourd’hui exposés dans des musées, recevait du papier, des couleurs, sans que les infirmières aient le projet explicite de la soigner ni l’idée qu’elle puisse guérir par la peinture. Elle a sans doute été un peu mieux traitée par deux ou trois personnes, parfois des visiteuses qui trouvaient belles ses peintures, mais il y avait aussi des infirmiers ou des médecins qui ne s’y intéressaient pas.
Les patients sont souvent restés très malades. Le fait d’être promus artistes, avec l’attitude d’une société qui l’admirait, n’a pas changé grand-chose à la pathologie elle-même.
Cela est vrai aussi pour les non-hospitalisés, un peu « fous », suivis hors les murs des asiles… On ne peut pas dire que le fait de peindre et d’être en relation avec des gens autour de leur création, a pu améliorer la pathologie. Il ne s’agit d’ailleurs pas de thérapie.
Le terme d’« art – thérapie » m’a toujours paru suspect. L’art n’est pas une médecine. Il peut y avoir une production magnifique malgré soi. Les « pensionnaires » ne se considèrent pas forcément comme des artistes.
Si les malades qui créent des œuvres ne se pensent pas artistes, comment se définissent-ils alors ?
On pourrait aller jusqu’à dire qu’ils ne se définissent pas. Ils sont là, ils demandent surtout à ce qu’on leur permette de faire ce qu’ils aiment faire, d’avoir du papier, des pinceaux ou de la pâte à modeler… Ils ont du plaisir à ce que des gens viennent visiter leur singularité.
La création peut-elle aider les malades à se projeter ailleurs, hors des pensées qui les envahissent, et d’une certaine manière à diminuer leurs souffrances mentales ?
Celui qui se consacre à l’art transforme son être – au – monde, probablement ; tout d’un coup il crée une ambiance qui lui convient, un entour autre que celui des soins, un monde particulier. Des gens souvent le félicitent. Mais penser qu’avec cette création on peut faire retour sur soi est chose rare. Peut-être pourrait-on même dire qu’il n’y a pas intérêt à guérir. C’est une production d’un monde imaginaire, fait d’images et de vraies compositions avec, un certain mode de représentation du sexe, des places dans la société, du rapport à l’animalité… mais tout cela, parfois très fécond, n’est pas une « guérison » peut-être une sorte d’accouchement.
La pathologie est bien présente dans les œuvres d’Aloïse … il y aurait là un lien entre la création et la folie. La schizophrénie serait-elle créatrice d’images ?
La schizophrénie est d’abord et avant tout très destructrice, à l’intérieur, en soi-même puisque la maladie fractionne l’être, le décompose. C’est presque toujours l’unité corporelle elle-même qui est attaquée. La peinture peut servir à recomposer, reconstruire ; on voit chez Aloïse émerger quelque chose de cet ordre-là, une échappée.
Aloïse a une histoire intéressante ; pendant très longtemps, elle n’a pas été « folle ». Après une série d’échecs professionnels, elle s’occupe d’enfants dans une famille bourgeoise. Elle est très cultivée. Qu’est-ce qui fait qu’elle craque en un moment donné ? La cause est probablement le renoncement à un certain nombre d’aspirations chez elle ; ses ambitions, au début, n’étaient sans doute pas d’être peintre.
Dans ses peintures, on peut voir un retraitement de la figure et du corps tout entier comme quelque chose qui est tout d’un coup un retour, une visite chez l’infantile. En même temps les lignes disparaissent et les images sont chargées de courbures et d’enveloppements. Les figures ne voient pas vraiment, elles sont souvent représentées par des trous noirs. Ces images sont la recomposition du monde corporel, sans recherche évidente de significations ou d’idées. Ce sont d’autres corps, ceux dont on n’a pas accouché.
Les dits « schizophrènes » sont aussi des créateurs, non forcément écrasés par leur folie. Ils sont en création permanente parfois de mots ou d’images, en tous cas d’autres mondes.
Vous évoquez Paul Klee dans votre livre, ce moment où il va en Tunisie à la rencontre des lumières du Sud pour qu’elles se confondent avec son Moi. Est-ce la recherche d’une expérience créatrice, l’évocation d’un rêve ou un délire ?
Klee n’est pas dans la folie, mais l’exploration presque délirante de la mort ; essayer d’aller voir de près ce qu’il en est, d’aller chercher l’instance figurale, l’autre de son œuvre, voir l’invisible. Jean-François Lyotard, philosophe, qui a mené une réflexion remarquable sur l’art et l’inconscient, pense que lors de cette expérience Paul Klee est allé dans un monde à la recherche de la mort, une sorte de découverte du rien. Comme dans le mythe d’Orphée, il descend aux enfers pour toucher l’impossible, l’extrême. Cela se voit dans les dessins, même s’ils sont parfois très érotiques. La question n’est pas sexuelle, c’est un rapport à ce qui disparaît. Il s’agit pour le peintre non pas de mourir, mais de savoir la mort, la vivre, la connaître, naître en même temps et fusionner avec elle.
C’est une grande expérience pour un artiste de s’approcher d’une « vision » ; encore plus d’une disparition. Connaître un royaume qui aspire à venir, un monde intermédiaire que l’artiste nomme entremonde. Klee recherche une obscurité commune et pas forcément une disparition.
Il cherche à plonger dans un vide, dans l’abstraction, c’est une expérience du néant qu’il décrit…
L’ambition de Klee est d’aller au plus près des formes élémentaires du « ressenti ». Jean-François Lyotard pense que l’essentiel de cet autre-là, le ressenti, ce sont les traits, les lignes, avec une insistante abstraction. À quoi cela ressemble ? Quelles sont les formes ?
Dans son livre « Discours, figure » le philosophe décrit les images des arts plastiques comme un territoire. L’œuvre relève d’un espace qui n’est pas celui de la langue ou de la parole. Un espace qui déborde complètement le « signifiant », qui ne se réduit pas et ne renvoie pas au discours, au verbe ou au signe. Cet espace autre est justement celui du désir…
Un espace où il n’y a pas de langue, pas de signification … on arrive à la frontière d’un autre monde ?
Lyotard s’oppose radicalement à l’interprétation des images. Elles ne veulent pas « dire » quelque chose d’autre que ce qu’elles font. Pour lui, l’œuvre plastique relève de ce que la langue ne peut pas explorer, peut-être la mort. Que sont finalement toutes ces formes bizarres, des hommes, des femmes, des déformations ? Gilles Deleuze a très bien compris que l’image peut bouleverser non simplement le rapport à l’autre, mais au monde, à la finitude. A un au-delà, comme dit Félix Guattari, à quelque chose qui nous échappe, mais qui est là, et qui est aussi de l’ordre de l’attirance et la tentation.
Entre l’art et la folie, où se situe l’Art brut ? Est-ce une rencontre fortuite ou un moment qui s’inscrit dans l’histoire de l’entre deux guerres ?
Je pense qu’il y a une certaine interdépendance entre l’Art brut et la folie. L’art, de temps en temps, a l’air fou, bizarre, autre que ce que l’on a vu. Un inattendu. Mais ce n’est pas forcément « fou » au sens de malade et ne suppose pas nécessairement une souffrance.
L’Art brut anticipe un moment donné de l’histoire dans les années 30, la guerre d’Espagne, puis les fureurs folles de la Seconde Guerre mondiale. On peut interpréter les tableaux, les sculptures d’art brut, sur ce fond d’Histoire. Que se passe-t-il ? Dans quoi vivons-nous ? Dans les années qui précèdent la Seconde guerre mondiale, les circonstances sont déjà violentes et menaçantes avec l’apparition du nazisme, le massacre généralisé. C’est une représentation au-delà de l’humain, des hommes, des femmes, du vivant.
De nombreux textes qui accompagnent les peintures de guerre au Musée d’Art brut de Lille, racontent la Résistance, les menaces permanentes de mort, d’assassinat. Il y a l’idée avec l’art brut que dans un climat comme celui-là la création reste ce qui est possible. Et puis, sans arrêt, on peut avoir affaire à ce qui est impossible et qui peut cesser d’être. Il y a une sorte de correspondance évidente entre toute cette période politique et l’Art brut qui, sans le savoir, l’annonce.
L’inconscient est une notion qui a toujours hanté les arts et la littérature. La psychanalyse est en mouvement avec l’Histoire, comment définir l’inconscient aujourd’hui ?
L’inconscient est ce qui continue de faire, produire, à notre insu. On ne sait même pas. On le sait parfois quand on rêve ou parce que l’on comprend quelque chose d’inattendu. Ou alors parce qu’on est émus. L’inconscient est bien là, mais n’a pas seulement la forme familialiste que Freud lui a donné. Freud disparu, les psychanalystes continuent d’élaborer cette notion, et même de leur vivant, on s’aperçoit que les gens bâtissent à leur façon l’inconscient. Jung, introduit le symbolique partout, et comme par hasard, le symbolique, toujours, aura un certain rapport avec le sexe. Deleuze, lui, esquisse un moment plus large. Il s’empare des objets du regard, les récits, scènes, tableaux, il étudie ce qui se montre, la peinture, les couleurs, le cinéma.
Donc, il faut aller au-delà. C’est la prétention de Lacan. Mais Lacan explore le monde du côté de la signifiance, de la Langue, du Verbe, de la Parole. Dès que l’on dit quelque chose, on énonce l’inconscient, malgré nous. A notre insu, il y a toujours le père, la mère, l’enfant, la castration…
Et quel serait le devenir de l’inconscient, jusqu’où nous mène-t-il ?
Il manque, aujourd’hui, une sorte particulière de dimension pour aborder ce que l’on appelle la subjectivité inconsciente et comprendre le monde. Félix Guattari, définit trois écologies : le politico-économique c’est-à-dire le capitalisme que nous vivons, puis la nature avec la terre, la verdure, les animaux, et la troisième, famille, sexualité, désir… Je pense qu’il en existe une quatrième essentielle qui est une écologie du néant ou de la néantisation, peu d’humains échappent à cela, à leur rapport avec une fin. Du point de vue de la vie humaine, il faut introduire cette dimension supplémentaire qui est là, d’autant plus présente qu’on la frôle tous les jours. Elle s’exprime au travers de la croyance, du religieux, qui occupent à l’heure actuelle la quasi-totalité du monde ; et la constance inébranlable des guerres.
Les artistes dans leurs œuvres ne nous donnent-ils pas à voir de ce que nous ne percevons pas ?
Je crois que les artistes aussi recherchent cette « quatrième dimension ». Ce sont des explorateurs fondamentalistes, plus que des esthètes. Ils ne veulent sans doute pas faire du beau, ce n’est pas ce qui les intéresse. Ils ont un rapport au Néant, à un au-delà extrêmement présent. On perçoit chez les peintres contemporains dit abstraits cette vision, à la frontière de la vie. On la voit aussi dans la peinture des « fous ».
Bibliographie
Politiques de l’inconscient – Essais pour une métapsychanalyse, érès, 2020
L’obscur objet du cinéma, Campagne première, 2009
Épreuves de la folie. Travail psychanalytique et processus psychotiques, (avec Danielle Sivadon) PUF, 1991
La Borde ou le droit à la folie (avec Danielle Sivadon), Calmann-Lévy, 1976
La médecine du capital, Maspero, 1971