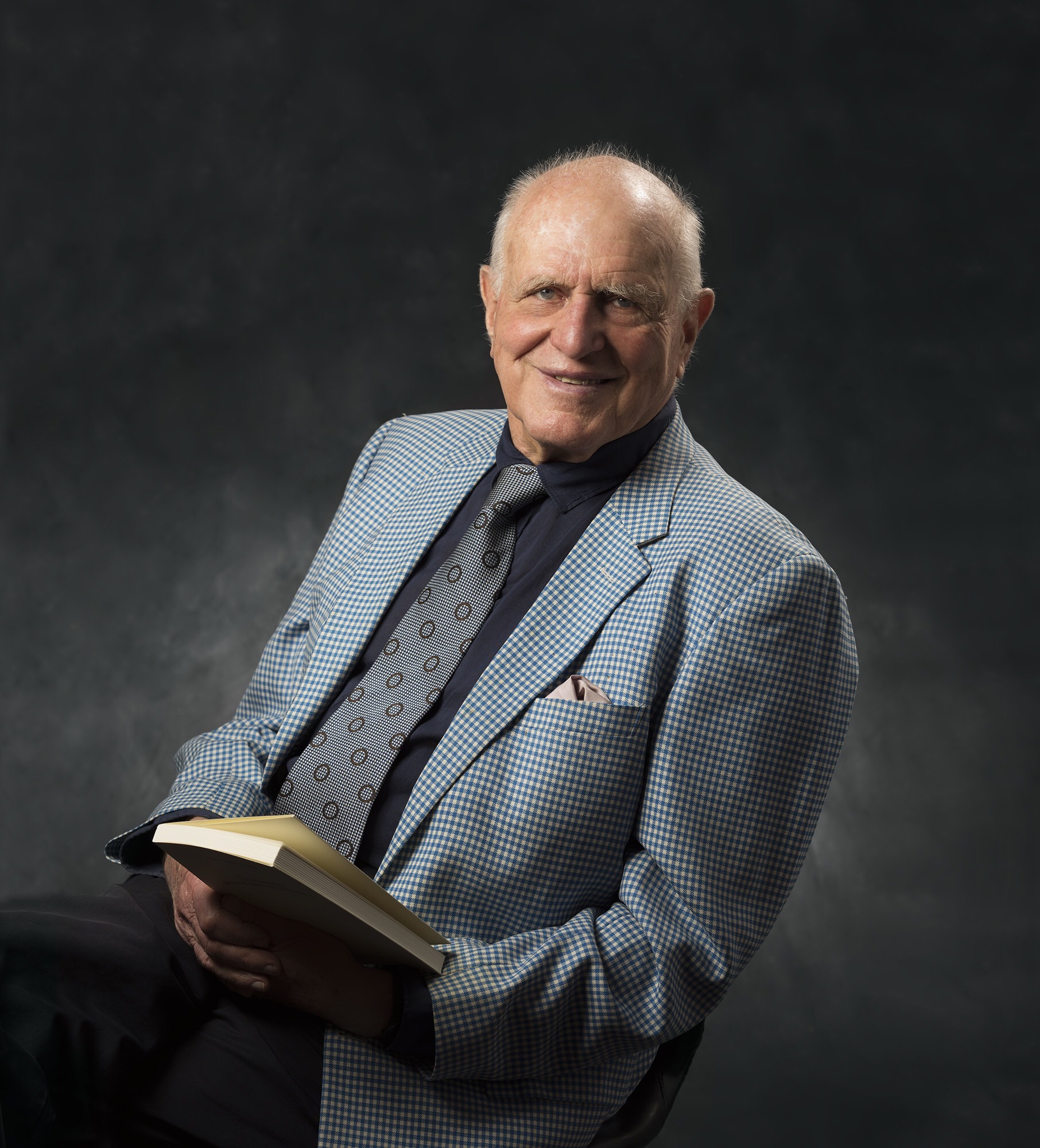Aventures d’un bibliothécaire (1)
par Henri Hugues Lejeune
Première Partie
Approche
Je me livre actuellement, de manière bien velléitaire, au rangement de mes livres. Velléitaire ? Car je ne sais guère comment réagir s’il est question de les classer et qui pourrait prétendre « ranger » des livres s’il ne les classe, ce qui revient malheureusement à dire se classer soi-même et où allons-nous dès lors ?
Je me suis ainsi trouvé à remettre au jour, sagement regroupés par de semblables reliures on ne peut plus banales un pot-pourri de textes érotiques, totalement sous le manteau et pourchassés de leur temps, qui se contentaient depuis d’éditions limitées et un peu discrètes dans les années 60, par une brèche élargie sous les coups de boutoir d’éditeurs hardis tels que Jean-Jacques Pauvert ou Régine Desforges sur les traces d’Apollinaire.
Je ne sais ce qu’il en est aujourd’hui, mais je suppose que leur caractère suranné limitera toujours plus ou moins leur diffusion pour des raisons banalement économiques. Mieux vaut dès lors mimer l’élitisme des séries limitées ?
Du moins leur sortie de l’enfer aura-t-elle eu le bon goût de procurer à ces éditions des commentateurs dignes d’eux.
Où, dans mon esprit, classer l’Enfer ? Je les ai donc relus, ce qui ne m’était pas arrivé de longue date, depuis notamment que je « fais » l’écrivain avec cet « esprit de sérieux » dont nous ricanions tant jadis à la suite de Sartre sans doute (l’Autodidacte), ceci avec une attention et une avidité dont je me suis trouvé surpris, voire un peu scandalisé de moi-même jusqu’au moment où diverses pistes m’ont ouvert l’esprit, justifiant éventuellement cet intérêt ?
Lecture divertissante, ne soyons pas hypocrite, mais les défauts de ces ouvrages sautent au visage dès que l’on s’avise de les considérer comme un ensemble voire même œuvre par œuvre. Tout se tient par épisodes, dans une sorte de suite de tableautins les plus animés qu’il se peut. Il ne faut pas oublier qu’ils étaient en général munis de gravures et d’illustrations plus ou moins lestement traitées, le mieux sans doute étant le plus incendiaire ? Des « sketches » dirait-on aujourd’hui plutôt que des saynètes ou des épisodes.
Dans cet esprit, les intervenants sont interchangeables, ô combien, assez schématisés comme d’une subreptice « Commedia dell’arte » : Grande Dame libidineuse, fausse ingénue promptement convertie, vive et facile soubrette, laquais insolent, mais plutôt athlétique, Chérubin éveillé ou éveillable, ravissant et entreprenant Chevalier, Gascon aussi vain qu’« intarissable » éventuellement, sans compter les indispensables variantes et combinaisons d’ecclésiastiques considérés comme des épices apparemment indispensables aux yeux gaulois. Le talent consistera à enchaîner le plus prestement possible ces excitants épisodes, un tel profil de narration laissant en plan d’autres caractéristiques éventuelles, la griffe de l’auteur par exemple et bien entendu la vraisemblance ?
Le tome I du « Diable au corps » d’Andréa de Nerciat me manque, le meilleur à mon avis et dans celui de mes souvenirs et je n’ai plus que le second, mais il comporte l’étude d’Apollinaire consacrée à l’auteur. Il y a « Les Aphrodites » dans leur ensemble, j’allais écrire le club des Aphrodites tant leur composition suggère le concept de cet anachronisme ; l’époque est prégnante de confraternités de préférence secrètes qui se retrouveraient en un même lieu, discrète Thélème. Il ne faut pas oublier que la Franc-Maçonnerie est en train de se mettre en place en ce XVIIIe finissant ; mais la bonne humeur, la gaieté sont aussi partout répandues, une table délicieuse n’est jamais loin, où se prolonge voire se renouvelle éventuellement l’affaire, sur nouveaux frais : nous sommes en France.
J’ai « Félicia ou Mes Fredaines » aussi, qui reste le plus connu de ses ouvrages, un roman à peu près construit s’il se termine lui aussi en un galimatias regroupant, pour une sorte de cérémonial libidineux plus ou moins bizarrement organisé une orgie générale de forme collective, mais de conception fumeuse… Là, l’ennui même, et l’uniformité ! Comme un lointain rappel, une nostalgie peut-être d’une Abbaye de Thélème et d’un humanisme à la recherche de nouvelles formulations ; bien répétitif hélas, mais qui n’est pas sans se retrouver un peu partout dans l’image de ces « abbayes » qui semblent, avec leurs habitants si variés une source de constantes folies imaginatives, chantées par La Fontaine et certes venues aussi du vieux fonds de l’Italie comme de l’anticléricalisme plus ou moins facétieux des Gaulois…
En fait Nerciat ne manque jamais d’insérer dans ses textes des raisonnements qu’il considère sans doute comme libérateurs, des jalons d’une « morale » élargie qui ne va pas jusqu’à généraliser ou à élucider vraiment les conséquences ou les fondements nouveaux voire sociaux qu’ils impliqueraient ; il ne cherche pas à aller trop loin, ce n’est pas le lieu et tout le monde avait lu Rousseau. Ils nous paraissent aujourd’hui mièvres et confus : on saute volontiers ces passages insipides et vagues, ce qui était peut-être le cas de l’auteur lui-même ; mais pensait-il ne pouvoir s’en dispenser, tenant à sa condition d’honnête homme. Après tout Nerciat présente la caractéristique rare dans ce genre d’avoir signé l’ensemble de ses ouvrages, si « infernaux » fussent-ils. Peut-être n’était-il jamais « sur place », ou à portée des argousins, voire intouchable en cette époque paradoxale déjà.
Certes l’Enfer ne se trouve pas vraiment par là. Tout le monde le sait. Mes auteurs le pressentent-ils ? Si les austères savants de la Bibliothèque qui allait devenir Nationale ont rendu cette dure sentence : créer l’Enfer, c’est pour d’autres raisons : Nerciat ni ses acolytes n’auraient sans doute pas été damnés pour eux-mêmes.
Pour en arriver là il s’agit de bien autre chose et d’un tout autre personnage.
Moins que jamais je ne songerais aujourd’hui à me retrouver, m’embourber surtout dans les méandres obscurs de la lourde bibliographie du Divin Marquis, pourtant de loin le mieux représenté du genre chez moi : je suis consciencieux, j’avais souvent tenté de juger sur pièces, d’aller en appel de moi-même à coup de relances d’enthousiastes thuriféraires me laissant honteux et solitaire dans mon anachronisme. Je détiens du coup ses ouvrages clefs, si je n’ai pas trop plongé dans les essais et les à-côtés de théâtre de journaux ou de pure doctrine puis j’ai fini par m’amuser de l’emphase de ses thuriféraires d’aujourd’hui, d’hier plutôt qu’à étudier les implications de ses thèmes et de ces thèses qui sont le corps de sa notoriété.
À parler franc tout m’est toujours tombé des mains, en de divers moments, en tout temps ; je n’ai même pas pu me résoudre à le lire jusqu’au bout de nulle part l’ayant toujours trouvé si illisible tant dans sa rédaction que le fil de ses idées, pesant quant au style, malhabile dans ses intrigues et leurs développements, voire dans l’acheminement de ses « idées » à l’intention de ses lecteurs, qu’à l’invraisemblable galerie de ses protagonistes, en un mot l’ai jugé surfait et considéré comme fatale son influence sur tous les plans, outre l’Enfer.
À mon sens, il a fait avorter le Romantisme du moins en France aussi bien qu’il a démodé ses pauvres confrères.
Il devait leur en imposer, ils étaient souvent obscurs gens de robe ou vagues chevaliers même quand ils ne se situaient pas dans la lignée du Chevalier de Seingalt … Peu d’entre eux Nerciat en tête, devaient ignorer son existence.
Il est vrai qu’il a terriblement payé de sa personne sans que l’on puisse dire avec certitude s’il était conscient de le faire au service de ses idées ou au sein d’un Sadomasochisme aux contours encore mal définis.
L’influence et le renom du sadisme par le simple truchement de la cruauté introduite dans le déroulement des intrigues galantes ou la mentalité de leurs héros et leurs idées s’enrobaient en outre de facto dans les volutes de la Révolution ll et traversent sourdement l’entier appareil de la pensée préromantique. Ceci n’a pas été sans leur donner à tous une résonance, un relief et une signification qui leur confère d’emblée une puissance secrète et un halo, une dose de la magie noire, apanage du Marquis, celle même qui les empêche en fait d’aller au bout d’eux-mêmes s’ils risquent de se hasarder sur ses traces. Sa malédiction sourde pèsera dès lors sur tout le monde, jusqu’à se profiler dans les non-dits du Romantisme Noir diagnostiqué de nos jours, le seul à la mode.
Quand la cruauté devint-elle le Sadisme ? Je ne saurais le dire autrement que quand Sade le décida, ce que pensent justement ses séides.
S’agissait-il vraiment là de pornographie ? Pornè en grec désignait une prostituée ? Certes les « Dialogues de Courtisanes » jalonnent la littérature légère dès ses origines ! Littérature de la prostitution dans son ensemble ou prostitution de la littérature ainsi confinée à une gestuelle de l’acte sexuel ?
Le Satiricon n’est pas un ouvrage que pornographique ! Est-il possible de trouver à cette littérature une vraie ou une vraisemblable origine ? Cruauté et sadisme se seraient invitées dans la pornographie qui serait ainsi évolutive, remplaçant aussi peu ou prou la truculence et la crudité que les Gaulois revendiquaient à l’égard certes d’eux-mêmes et bien volontiers de leur clergé !
Ou peut-être lui sont-elles intrinsèques, congénitales et se doivent-elles de réapparaître, en filigrane du moins, au long des intrigues ; elles s’avéreraient indispensables à un moment donné, comme un condiment, afin de les développer et de les enrichir, dès lors que doivent intervenir les moteurs des diverses passions humaines. Sade ainsi les aurait-il fait ressortir, car il en était, plus que les autres, la l’idée me vint d’abord d’une sorte de tableau synoptique ou de triptyque où disposer leurs caractéristiques et d’en faire la synthèse ? Le résultat n’est pas bon ; qui mettre au centre, comment les situer ainsi, et puis aucune de leurs caractéristiques ne se compare aux autres de manière satisfaisante. À chaque confrontation, l’un de mes sujets, malicieux, s’échappe comme pour me narguer. Pour son plus grand bonheur, l’esprit humain est capricieux.
Mon triumvirat figurera la littérature libertine typique, je pressens même qu’il en est une sorte d’arrière-garde avant que ne survienne le raz-de-marée qui s’amorce ? Une brutalité qui s’était masquée jusqu’ici : dans libertinage, il y a liberté encore.
La tragédie n’était pas bienvenue ni évidente, mais le drame latent ne s’évacuait déjà qu’à force de pirouettes, de masques, de carnavals : il sera toujours temps après la fête de se souvenir que les filles tombent enceintes, que la courtisane frôle la prostituée, que les jaloux tyrannisent et enferment, que la folie gronde, et que le mal, la pauvreté, et le malheur existent. Il n’y aura que trop tôt lieu de s’en souvenir.
Aussi m’en vais-je tenir au bon vieil ordre chronologique.
Les livres de l’époque, disons le XVIIIe siècle, avaient un très petit tirage, a fortiori quand ils avaient quelque chose à se reprocher ou pas pris la peine d’affronter cette autorité qui seule permettait l’impression.
Pour qui voulait y échapper, il était bien pratique d’être édité en une contrée voisine moins regardante en principe, voire d’imprimer et de tirer en France et d’assembler ailleurs ou simplement d’en faire semblant. Certains se défendaient par éditeurs (libraires) et auteurs interposés, tentaient d’attendrir des pouvoirs plus ou moins sourcilleux selon les circonstances et les époques comme de faire si possible intervenir de puissants protecteurs divers et variés.
Les ouvrages particulièrement licencieux qui n’avaient aucun espoir sur ce plan-là optaient bon gré mal gré pour la clandestinité.
Fort bien, mais le doyen céans, indiscutablement « Les Secrets de l’Amour » de ce côté-là, semble avoir vécu une vie assez paisible dans sa région dauphinoise tout au long de la parution étagée de ses divers dialogues dans la seconde partie du XVIIe siècle : il est vrai qu’il a été publié et, selon toute apparence, rédigé en Latin !
Il est d’autant plus remarquable qu’un auteur tel que Andréa de Nerciat, écrivant et publiant sous son nom, passât entre les gouttes. Sa vie fût tumultueuse, très internationale (ce qui dut lui faciliter les choses) et quasi inexplicable et inexpliquée en une époque très agitée elle aussi.
Quant au, « Portier des Chartreux » activement pourchassé aussitôt paru à deux cent exemplaires au début de 1741, le détail de ces procédures, assez bien connu, révèle une prudence particulière en ce qui concerne ses modalités de production et d’origine si ses diffuseurs, gens plus modestes, se retrouvaient, pour peu de temps il est vrai, à la Bastille.
Le plus ancien ouvrage de mon lot donc ce sont ces deux volumes « Les Secrets de l’Amour », qui ont fait leur apparition en 1660 à Lyon et qui sous des apparences fort classiques en leur genre, recèlent des tonnes de malice.
Il s’agit d’une suite de dialogues dont le style général remonte à l’antiquité, aux Dialogues de Courtisanes (ou pas) par exemple, genre lointain satirique et lascif, mais toujours révéré et suivi, fidèlement repris sur nouveaux frais par Boccace puis par l’Arétin en pleine Renaissance, au milieu du XVIe surtout, avec le plus grand retentissement l’un comme l’autre, qui vinrent se greffer sur la veine de la truculence, de la comédie de mœurs, le fond graveleux et libératoire de toute civilisation qui se respecte.
Les « Ragionamenti » de L’Arétin auraient ainsi été la source universelle de l’érotisme moderne d’après André Berry leur préfacier.
Oh, nos Dialogues présentaient toutes les garanties et toutes les méditerranéités possibles. Je dirais même qu’ils en remettent !
« Parmi les monuments de la littérature érotique, il n’en est pas de plus célèbre que la « Satire Sotadique d’Aloisia sur les arcanes de l’Amour et de Venus », publiée par étapes, sous une forme incomplète, puis complétée, puis complète dans la seconde moitié du XVIIe siècle et présentée au départ comme l’œuvre espagnole de Lisa Sigea, mise en latin par Jean Meursius. Il n’est pas non plus d’ouvrage connu sous plus d’appellations… » écrit André Berry puisqu’on a pris tour à tour pour le désigner chacun des éléments du puzzle, auquel s’ajouta un jour, un maillon comme un autre, le nom du véritable auteur, Chorier, dont la base était Grenoble, où aurait paru la première traduction en français en 1680, ensuite adaptée par l’abbé Terrasson !
Or comme Jean Meursius, Luisa Aloisia est parfaitement historique. Née à Tolède en 1530, elle était fille d’honneur de Dona Maria, fille de Jean III de Portugal, parlait huit langues et tenait une place importante à la Cour du Portugal. Elle écrivit de nombreux ouvrages d’érudition des plus austères d’ordre philosophique et moral, correspondait avec nombre de grands esprits européens dont le Pape Jean II et avait été saluée Minerve de son siècle ; elle mourut vers 1560, écrivait en espagnol. Il était impossible que cette grave personne eût commis ces prétendus dialogues presque autant que de les voir traduits par Jean Meursius « dans son jeune âge », celui-là né en 1613 à Leyde, austère savant latinisant, qui devint une lumière de l’Académie locale, tandis que leur version originale en espagnol aurait entretemps disparue…
Tous les caractères par contre du parfait canular !
Les six premiers dialogues se déroulent en Italie, le septième en Espagne. L’ouvrage s’était de surcroît agrémenté un beau jour d’une éloquente et érudite justification préliminaire de Luisa expédiée des Champs-Élysées…
Il s’agit d’une sorte d’Art d’Aimer inspiré de l’Antiquité entrelardé d’anecdotes et de récits démarquant les chefs d’œuvre classiques au long cours de la littérature érotique peut-être pimentée, aromatisée dit-on de divers épisodes contemporains connus de l’auteur assez vite connu, un Nicolas Chorier, juriste dauphinois notoire et grand latiniste, d’une qualité de rédaction peu commune dans cette langue dans laquelle il publiait régulièrement… Lui-même eut une vie mouvementée, mais brillante avec des hauts et des bas assez pittoresques: polémiques et querelles, succès et disgrâces, amis fidèles et ennemis déclarés où le halo de L’Aloisia, un des noms usuels de notre ouvrage, n’a sans doute pas été pour rien.
Ce qui n’empêcha pas d’éminents juristes régionaux d’en financer certaines éditions dont la traduction française.
Bref on savait s’amuser alors en Dauphiné et Nicolas Chorier serait ainsi dès le XVIIe siècle incontestable inventeur du canular dans l’esprit Normalien le plus pur : impeccable et rigoureuse érudition, inspiration de la loufoquerie la plus débridée et provocation par-dessus le marché. Jean-Paul Sartre par exemple dont l’Histoire veut qu’il ait été en son temps l’instigateur des plus poussés et des plus dévastateurs qui furent, n’aurait pas fait mieux, en plus d’être capable de le réaliser.
Les exégètes contemporains, savants eux-mêmes, tiennent que le livre, outre un catalogue des lubricités disponibles aux êtres humains, constitue un courageux répertoire et une nomenclature plus systématique qu’il n’y paraît des comportements masculin et féminin, sous l’angle intime, pris dans un certain monde ? La minutie des descriptions est souvent si répétitive que le lecteur contemporain vacille un peu et l’on ne sait parfois plus très bien où l’on en est …
Ainsi Chorier est-il un ancêtre ; si l’existence de l’ouvrage lui a visiblement apporté de nombreux troubles dans sa vie, il ne paraît pas que les éditions successives (8 de son vivant), aient rencontré de bien grandes difficultés dans leur publication matérielle : elles venaient presque chaque fois épiscopal avec des modifications diverses et souvent des rajouts. Le caractère un peu ésotérique et élitiste de l’affaire, son régionalisme peut-être, le tout regroupant des gens de Robe éminents la camouflaient-elle ?
Ce « Milieu » semble l’avoir couvert au point qu’à la fin de sa longue vie l’auteur ne dissimulait plus guère sa paternité.
De ce point de vue, l’« Histoire de Dom B… Portier des Chartreux » est une toute autre affaire ; dans les premiers jours de 1741 sa parution dans la clandestinité la plus totale ouvrit aussitôt contre lui la chasse. Sa diffusion mène tout droit à la Bastille. Grâce à cela nous avons bien des détails sur l’enquête ; après tout le Cardinal de Fleury est encore Premier ministre, le dernier de son état épiscopal (il sera tenu au courant de l’enquête), Louis XIV est mort il y a 25 ans. Dès le 4 février, on perquisitionne chez un graveur, trois personnes sont envoyées à la Bastille le 28.
Oui, mais voilà, tous les suspects, qu’ils avouent ou qu’ils protestent, sont plus ou moins des récidivistes en livres clandestins ou de modestes colporteurs. On rate de peu à Rouen des envois de balles d’exemplaires non reliés vers la Hollande, une mouche révèle un portrait-robot de l’auteur présumé et de son environnement, un jeune juriste (là encore !) de 25 ans qui n’ira pas en prison, dont on ne sait pas s’il a été même inquiété et fera tranquillement carrière, les imprimeurs ont eu de visibles complicités dans « La Haute » ; dès juillet-août tout le monde retrouve la liberté ; quelques clercs et une ancienne actrice « exilés » en province -c’est le terme qu’on employait- ne semblent pas y être restés bien longtemps s’ils n’y furent jamais.
Or visiblement la notoriété et le scandale entourèrent constamment l’ouvrage, malgré la facilité des mœurs d’alors. Sans doute ne voulut-on pas en remettre. Mais l’autorité n’interviendra plus.
Après quelques errements, la certitude historique détermine l’auteur comme Jean-Charles Gervaise de Latouche, né à Amiens en 1715 qui n’écrivit pas grand-chose d’autre, mais fit carrière en tant qu’avocat au Parlement de Paris. Il serait mort de chagrin et d’angoisse (le 28 novembre 1782) ayant perdu tous ses avoirs dans une banqueroute. Le ciel se sera vengé !
Aucun des documents dont nous disposons, qui sont assez nombreux, ne montre qu’il aurait été éventuellement poursuivi au titre d’auteur, son nom avait pourtant été cité parmi d’autres, à titre indicatif… par des indicateurs
Au temps de l’enquête il était clerc de Procureur, emploi où à l’époque de jeunes ou futurs avocats effectuaient souvent une sorte de stage. Cette profession était à risque pour les Autorités du fait de ses connaissances techniques de la justice, ses relations et de la solidarité qui prévalait chez les gens de Robe. La police n’enquêtait à leur sujet que sur ordre, ce qui ne semble pas avoir été franchement le cas. Un de ses collègues, dont le nom avait circulé avec le sien fut arrêté et interrogé, mais se disculpa apparemment avec facilité. Il est curieux que l’on soit redevable à ce milieu de deux des plus grands, des plus célèbres du moins, de ce genre de livres « libertins », l’un à Grenoble un siècle avant l’autre. La Robe faisait partie du Tiers-Etat certes, mais plus à l’abri que le commun.
Nerciat lui-même bien que davantage porté vers les armes que vers la toge, était fils d’un trésorier au Parlement de Bourgogne et mit ainsi facilement le pied dans l’Etat ; il bénéficia d’une éducation classique poussée avant que sa nature indépendante ne le portât très jeune à voyager pour la parfaire dit Apollinaire (mais aussi peut-être aussi pour s’en libérer ?) à travers l’Europe où il se sentait partout chez lui ; sa famille était d’origine napolitaine et aussi implantée en Sicile, dans le Languedoc. Il avait l’âme internationale d’alors. Ce fut cet intermède européen dont les Italiens au reste avaient jadis donné le branle en exportant vers nous reines, condottiere (Concini et … Mazarin) : Casanova rêvait-il plus tard de retrouver le poste ?
Faut-il inférer une volonté d’indépendance et de critique sociale du système dans les hardiesses des livres ouvrages de Nerciat ? Sans aller jusque-là, disons qu’il y a liberté dans le mot libertinage et que ces messieurs de la Robe, puissants et assez solidaires se sentaient plus à leur aise pour s’exprimer que les autres, à part la noblesse bien sûr, mais celle-ci plus assujettie à la Cour où il y avait peu de frondeurs, mais de taille : Mirabeau, qui écrivait chaudement, Sade lui-même, le duc d’Orléans, maints amis de Voltaire et Voltaire en personne -en risque calculé, tout ceci n’était pas peu et les mœurs par ailleurs, au moins à Paris, étaient fort libertines en elles-mêmes et libérées au moins dans certaines couches sociales, l’élite s’il faut bien l’appeler par son nom et par ricochet ceux qui l’entouraient.
Dois-je rappeler par ailleurs l’immense, la gigantesque contribution du fonds gaillard, truculent, gaulois qui en est déjà synonyme ; toute la culture médiévale de fabliaux, des « farces », des contes sur la gaillardise cléricale retranscrits même dans les couvents ainsi que les satires, le tout revitalisé dans les milieux cultivés par l’apport de l’esprit italien de Boccace, contemporain de notre moyen âge, resservi par l’Arioste
un siècle plus tard. De tout ce bagage l’égrillardise monacale constitue si j’ose dire un pilier. La Reine de Navarre, La Fontaine puisent là de leurs récits…
Les voici maintenant, en ces premiers jours de 1741 à la base de ce « Portier des Chartreux » , qui orne mes rayons et qui a survécu sans nul doute à bien des oubliés.
Il ne fait pas dans la dentelle, il charge tous azimuts. S’il laisse de côté le Trône, il s’en prend sur un ton de violence absolue à l’Autel, et s’il le fait dans la veine classique, il a un relent plus plébéien et provincial que par le passé. Les personnages que l’on présente ici sont essentiellement moines et moniales et non pas tant abbés ou abbesses ; prêtres de paroisse campagnarde ou curés bien plutôt qu’évêques et si l’on se retrouve dans la société civile l’on n’y fait pas de manières, le livre est de fait violemment anticlérical, brutal dans son déroulement et il s’en tient là.
Certes tous les accessoires du folklore libidineux habituel s’y retrouvent, les moines sont toujours hantés, obnubilés nous dirions obsédés par le sexe et la sexualité, leur puissance à cet égard et leurs attributs, leur avidité constante, ne désarment jamais conformément à la tradition. Leur ingéniosité sur ce plan n’a pas de fond, mâles ou femelles.
Il faut dire que les laïcs leur fournissent sans discussion la réplique pour contribuer au déroulement du récit, interlocuteurs éventuels de tous âges et de toutes conditions, mais on ne va pas plus loin que le château local ou la paroisse voisine. Paris est loin qui n’interviendra qu’en conclusion fatale du récit…
C’est écrit par un Parisien sans doute, mais d’adoption. Ou s’agit-il là d’un exil à la campagne pour se détacher, accentuer et souligner la vulgarité de l’ambiance ?
L’esprit, la conduite de l’action, la manière des protagonistes de la mener, comme celle de la raconter, s’est faite grossière, parfois d’une fausse ingénuité godiche.
Le héros-récitant est d’abord un jeune villageois à peine pubère, mais déjà, nous l’apprendrons très vite, de « tout » armé et tant que l’on veut (ou à peu près), grâce à cette veine « monacale » qu’il s’est toujours sentie. Mais au moral si une telle chose existe chez lui, il est et demeurera toujours perpétuellement ballotté par les circonstances ; ce genre littéraire n’aime pas se confiner dans une intrigue proprement dite. L’environnement préféré demeure une cascade de hasards.
Cette vision à ras de terre, cyniquement réaliste sera sienne d’un bout à l’autre même s’il se fait plus rusé avec le temps. Il est aussi le prisonnier, conscient ou pas, de ce hasard qui reste le grand pourvoyeur de tous ces érotomanes de la littérature libertine, objets ou heureux bénéficiaire des évènements ou parfois leur victime, mais guère leur initiateur : la psychologie n’est pas de mise.
Il ne se chargera de les mettre brillamment en œuvre que bien plus tard, lorsque devenu moine lui-même et ordonné prêtre, il sera initié aux « secrets » les plus graveleux et les plus scandaleux du livre : cela justement qui, malgré toute la licence contemporaine, ne pouvait être admis.
La méchanceté latente, le sadisme encore masqué, innomé, le malheur, le climat des circonstances, dites cruelles ou heureuses et d’apparence absurdes, leur ouvre la porte ; le « Malheur », personnage multiforme, victimise, accable d’abord les deux héroïnes du récit… et le narrateur est aussi leur inconscient et « innocent » bourreau.
Victimes-esclaves de leur dépendance absolue à leur tempérament, à la dictature de leur sens, elles arpentent indéfiniment de long en large les cercles de leurs divers enfers, de leurs cages : le couvent est une geôle absolue, inexorable, un enfer qui s’illumine de temps à autre de la jouissance effrénée de la luxure, généralement sous formes d’orgies lascives, collectives, confinées sur elles-mêmes où elles et eux se déchaînent dans le vide absolu, le néant en fait, sans le moindre écho. La satire ne se donne même pas la peine de se peindre de politique. La « bougrerie » comme on disait alors est le domaine de certains d’entre eux, décideurs souvent, qui s’en servent éventuellement comme d’une sorte de cotisation d’entrée du cercle des réjouissances ; ils sont parfois peints de vilaines couleurs.
Dans cette palette, l’inceste ici (comme ailleurs) se traite de manière intéressante, inattendue comme pour réveiller et pimenter les circonstances : il est évident qu’il ne fait guère ciller grand monde s’il faut bien de toute manière le retrouver quelque part dans le tourbillon et l’enchaînement des galipettes qui donnent leur rythme à ce genre de littérature, dans un temps où d’ailleurs l’ubiquité identitaire est un ressort d’intrigues, de comédies et de curiosité utilisé par nombre de conteurs d’histoires (la Commedia dell Arte, Molière ?), je n’ose dire de romanciers. L’être et le paraître, n’est-ce pas aussi un régal du libidineux ? Et ainsi se peuvent jouer diverses saynètes. On le trouve là comme un hasard, un piment certes, mais on ne le recherche pas au premier chef, on le retrouve au passage. En des temps où l’on vivait dans des ensembles plus confinés et clos sur eux-mêmes, peu conscients de la consanguinité et de ses effets, ce détournement certes prohibé aurait-il été mis sous le tapis plutôt que réprouvé en tant que tel ? Il est parfois présent, mais on ne le met pas à part ni ne le souligne.
Le « Portier des Chartreux » est à cet égard spectaculaire : le narrateur, très jeune, entre en jeu au cours d’une scène paroxystique initiée par celle qu’il croit sa mère, qu’il espionne dans sa chambre en galante compagnie avec un bon Père. Il avait amené sa sœur aînée qu’il s’efforce de faire bénéficier de l’exemple qu’il voit et le bruit qu’ils font là alerte les « grandes personnes ». Elles tombent en plein spectacle et sa mère l’en arrache pour se précipiter sur lui pour s’achever.
Quand, bien plus tard, il apprend la vérité, il se retrouve au côté d’une moniale qui l’avait jadis conçu à l’occasion une orgie conventuelle symétrique (il s’agit là d’une tradition!) là même où il s’apprêtait à en obtenir, d’elle justement, les « dernières faveurs » .
Nul n’y verrait le moindre inconvénient au contraire, mais une délicieuse réticence s’empare alors de lui et il se rabat sur une partie carrée où ils officient l’un et l’autre, mais en un dos-à-dos qui leur permet d’imprimer leur rythme à l’ensemble, sous les applaudissements de l’honorable compagnie.
Quant à cette fausse sœur aînée, elle vivra toujours de malchance, recluse dans divers couvents à l’instar de l’autre héroïne, quasi-nonne emprisonnée là par force. Elles seront les deux innocentes persécutées, esclaves de leurs sens et vouées aux catastrophes voulues par le hasard ou plus cruellement déclenchées par les brutalités inconsidérées des sens du narrateur qui se rue sur l’immédiat bien plutôt qu’il ne se préoccupe de leur sauvegarde.
La manifestation la plus violente, qui a dû être la plus scandaleuse à l’époque est la véritable machine à faire le mal, la leçon sur l’art de confesser les dévotes pour les amener à résipiscence qu’enseigne au narrateur enfin devenu prêtre, donc Père, un aîné avisé, ceci afin de le convaincre de s’orienter, grâce à la pratique d’une hypocrisie absolue, à détourner la fonction de confesseur pour être à même de repaître sa nature libidineuse : hypocrisie absolue et savant détournement de leur amour divin éventuel.
Sade qui avait certainement lu ce classique contemporain du libertinage n’a pas raisonné autrement…
Voici qu’avec Nerciat l’on a affaire à un véritable auteur en chair et en os et non plus un porte-plume évanescent, Guignol animant des marionnettes. Un auteur et un personnage original de surcroît…
Emile Henriot qui parle de lui dans son ouvrage sur « Les écrivains du second rayon » dit de ses ouailles qu’ils mettaient souvent dans leur vie ce qui parfois manquait à leur œuvre et Guillaume Apollinaire avait d’ores et déjà écrit la première étude à lui consacrée.
Ce personnage à la vie énigmatique et très bizarre n’était nullement le premier venu, l’histoire conserve sa trace dans ses marges, mais il ne survit que par ses érotiques qui à lui sans doute devaient paraître bien secondaires, des sortes de bagatelles et d’amusettes qui devaient peut-être leur existence à ce qu’une telle chose était à coup sûr de mode sans doute, mais aussi en passe de cesser de l’être et qu’il le regrettait quelque part et voulait s’accrocher à cette liberté qu’il sentait en péril.
Il reste très mystérieux sinon dans ce qu’il fit, car cela était souvent assez important pour en laisser la trace et en des lieux souvent bien insolites, mais rien en général de ce qui le lui fit accomplir n’est demeuré compréhensible vu de loin ni surtout que ce fut lui qui en ait été chargé. Il est vrai que l’époque (1739-1802) était aussi agitée que lui. Il en fit beaucoup c’est indéniable et surtout de l’inattendu ; à l’instar d’un Casanova il semble vu d’ici qu’il vécût plus vite que son époque.
Il est né à Dijon donc en 1739 dans une famille d’origine napolitaine de petite noblesse qui avait essaimé aussi en Sicile et dans le Languedoc. À Dijon ils étaient gens de Robe eux aussi : son père avocat, un oncle avocat-payeur au Parlement.
Il reçut une éducation soignée, mais très jeune quitta la France pour voyager en Italie, en Allemagne dont il apprit les langues. Il épousa à quelque moment le métier des car il prend du service au Danemark en qualité de capitaine d’infanterie puis rentre en France et sert dans la Maison du Roi (les anciens Mousquetaires noirs ), unité qui sera dissoute en 1776 ; il y était lieutenant-colonel, cela l’affectera et il en fera indirectement mention dans ses écrits.
Sa vie alors est mondaine sans doute, éventuellement licencieuse ? Mais les traces que l’on en peut avoir ne concernent nulle part cet aspect.
Il fréquentait le salon certes mal famé, qui sentait un peu le soufre, du Marquis de Luchet, avait écrit une comédie représentée sans grand succès, de petites partitions qu’il met éventuellement lui-même en musique ou des poèmes légers ou élégiaques dans le goût de l’époque (il écrira plus tard et mettra en musique un opéra-comique joué en Allemagne). Bref il touche à tout sans beaucoup de relief, mais non sans un « joli » talent. Il en ira toujours de même toute sa vie, qu’il mènera dans cet esprit du siècle dont il participe pleinement, mais souvent non sans courage ( ce qui était aussi de règle).
Mais quelque chose survient ou tout un ensemble ; les Luchet ruinés, leur salon déconsidéré, des ennuis sentimentaux visibles en filigrane de rares poésies lyriques passablement convenues dans ses œuvres, les séquelles aussi de la perte de son rang militaire ?
Ennuyé apparemment -et déprimé ? – il repart en voyage.
Il va en Suisse, retourne en Allemagne, erre pendant cette année 1776 qu’il termine à Bruxelles, Namur, Louvain. Il publie des Contes Nouveaux (sans intérêt paraît-il) dédiés au Prince de Ligne qui ne parlera cependant pas de lui. Ainsi le feront nombre de ces grands de ce monde qu’il approcha de près ou de loin, nous en avons des preuves tangibles, mais ils ne s’en vantent pas : sa renommée en tant qu’auteur licencieux en aura-t-elle été la cause ou plutôt une personnalité par trop sulfureuse ? Car le Prince par exemple n’était pas bégueule ; il entretenait de cordiaux rapports avec Casanova qu’il encourageait dans la rédaction de ses Mémoires.
D’après les gens qui s’intéressent à lui, ce serait vers ces époques qu’il serait devenu agent secret ou du moins chargé de négociations d’affaires internationales discrètes. C’était une attitude naturelle aux chevaliers d’industrie de l’époque qui peut nous paraître curieuse : Casanova avait bien été chargé de mission par les autorités françaises pour négocier un emprunt aux Pays-Bas !
On le retrouve à Strasbourg en 1778 où il fait éditer sa comédie de Versailles, il visite les bords du Rhin, publie en Allemagne une édition personnelle de Félicia (qui avait déjà paru… en dehors de lui ! dans de très mauvaises éditions), s’éprend de la poésie allemande du temps, plus particulièrement des auteurs archaïsants de l’Association Anacréontique et de Von Kleist : (il est vrai que les grands auteurs du siècle sont encore dans les limbes) il semble décidément aimer archaïser, dans une veine de libération complète de la personne humaine, de l’individu, masculin ou féminin) : une imaginaire anarchie aristocratique qui aura toujours eu des partisans au cours de l’histoire ? (Est-elle modes épisodiques ou courant de pensée ?). Il montrera tout au long de sa vie une curiosité, un éclectisme et une recherche de nouveauté et « d’avant-garde » très poussés qui ne sont pas tant d’époque du moins dans ces aspects-là.
Il séjournera plus longuement en 1780 à la Cour du Landgrave de Hesse-Cassel ; celui-ci y a établi une parodie de cour à la française, où tout se déroule comme en un petit Versailles. Il y retrouve le Marquis de Luchet, échoué là, un peu laissé pour compte : ruiné et plus ou moins écarté de Paris. Il était grand ami de Voltaire qui l’avait casé là auprès du Prince. Il avait plu, l’on ne jurait que par lui ; son titre officiel était intendant de la musique et des spectacles.
La musique française triomphait alors (!) là-bas et l’idée d’un opéra-comique français parut géniale : Nerciat écrivit donc livret et musiques de « Constance ou L’Heureuse Félicité », cet opéra-comique en trois actes, qu’il y présenta avec une troupe importée à cet effet…
Tout cela était bel et bon, mais il advint que Luchet lui obtint une fonction administrative de Sous-Bibliothécaire du Landgrave ; ces légers Français décidèrent d’y revoir de fond en comble un classement établi au fil des ans par de graves et méthodiques érudits allemands qui n’entendaient pas se laisser faire et le firent savoir. D’une façon générale, cette cour « légère » et superficielle autant que coûteuse ne plaisait guère au bon peuple du coin, peu francophile de nature et la chose dégénéra en guerre picrocholine, envenimant au moins provisoirement ses relations avec Luchet : bref il quitte Cassel en juin 1782 pour entrer au service du Prince de Hesse qui en fait son directeur des Bâtiments ; il fut fait Baron du Saint-Empire. Il ne se plut pas trop, là encore, dans des fonctions sans doute prosaïques où il ne s’attarda guère puisqu’il revint à Paris en 1783. Il conserva malgré tout d’excellents amis parmi toutes les petites cours d’Allemagne et y entretint ainsi une sorte de réseau.
Là il se maria : ici règne une équivoque complexe que l’on semble n’avoir pas résolue : il avait été question d’une épouse qui serait morte en couches à Cassel ou serait-ce la même qu’il ramena en France et épousa alors ? Toujours est-il qu’il aura deux fils qui firent leurs études en boursiers de la très jeune république, honorablement carrière ayant visiblement épuisé tout l’esprit d’aventure d’un père dont sa famille plus tard ne cessera de chanter les qualités, poussant le reste sous le tapis. Sa veuve épousera un préfet de Louis XVIII.
En attendant il était revenu en une France en passe de révolution où il avait repris le métier des armes. Ce qui serait alors le moment où il devint agent secret s’il faut en croire Apollinaire ; colonel il était, colonel il resta et les missions à lui confiées certes secrètes et pour le moins confidentielles étaient de quelque importance ; il fut ainsi envoyé en 1788 en Hollande pour envisager le soutien en sous-main des révoltés des cités contre le Stathouder et il reçut la croix de Saint-Louis au moment même où, peu rancunier à l’égard de Louvet de Couvray qui s’était tant inspiré de lui, il publiait « Les galanteries du jeune Chevalier de Faublas » pour affirmer une supériorité et une antériorité peut-être ? Ce genre de littérature relevait -surtout aux yeux de Nerciat- une légèreté d’être qui était assez loin de l’auteur des Aventures du Chevalier de Faublas.
On ne sait rien de lui pendant les débuts de la Révolution, au travers de laquelle il passa visiblement sans le moindre encombre puisqu’au début du moins elle lui confia on ne sait quelles tractations entre elle et le monde extérieur bien qu’il la détestât et en dît pis que pendre dans ses ouvrages. Il aurait véhiculé des propositions émanant des coalisés de l’Armée de Brunswick… où il servait lui-même, concernant plus spécifiquement le Royaume de Naples, relatives au Roi Louis XVI ? Elles tombèrent à plat certes, mais la République lui donnera un visa de retour. Ses relations visiblement notoires avec la Couronne de Naples remontent-elles à cette époque ?
Il fit de la police, cela est sûr : l’ambassadeur de la République à Naples écrivait à Talleyrand en 1797 pour l’informer que Naples avait chargé Nerciat (ayant donc de nouveau regagné Paris !) de surveiller pour son compte les faits et gestes de Mme de Bonaparte… ! Celui-là faisait-il lui-même du zèle ?
Il regagna Naples. Il évoluait alors en tant que colonel. Il ne se fit pas faute de faire état alors de sa « rupture » avec la République, entrer officiellement au service de la Reine et s’y faire passer pour ayant émigré afin de retourner dans son pays d’origine. Toujours est-il qu’il fut (ainsi ?) fort bien accueilli à la Cour. On ne sait trop s’il était là encore agent double, ce qui faisait figure de courtier en ces époques encore courtoises ? Toujours est-il que la Reine Marie-Caroline l’envoie en 1798 à Rome pour une mission secrète auprès du Pape: ce fut hélas la mission de trop, il arriva à Rome au moment même où les armées françaises du Directoire s’emparaient de la ville.
Il est coffré au Château Saint-Ange où il croupit deux ans. Elargi en 1800, gravement malade et ayant tout perdu, il mourut en 1801, à peine après la fin de ce XVIIIe siècle où il s’inscrivit si bien.
Cette existence flamboyante à la fois et déconcertante, insaisissable, ou la fantaisie prend si souvent le pas sur la raison est bien plus romanesque que ses romans qui ne rêvent, pour accomplir leurs polissonneries, que paisibles thébaïdes.
Sous la Restauration sa respectable famille feignait de considérer la partie libertine de son œuvre comme un divertissement de jeunesse, or c’est démenti par tout ce que l’on en peut savoir : trente-huit ans pour les Aphrodites, cinquante pour Le Diable au corps, « Félicia ou mes fredaines » ayant tracé la route avec succès. En ce qui concerne la matière romanesque, c’est donc indéniable.
Quand il versifiait, l’auteur confiait dans ses vers les plus touchant ses regrets de quitter les chemins de Paphos sur la fin douloureuse d’une passion. Ceci sur un ton qui n’était pas dans le goût de l’époque, ni même de ses propres œuvres, sinon davantage de ces poètes allemands qui lui étaient chers. Pour entendre ces harmonieux développements, il nous faudra attendre les Romantiques si l’on n’a pas lu Bérénice.
Mais Nerciat eut toujours la coquetterie de ne jamais se renier, invoquait la légèreté d’être.
Il est mystérieux aussi non tant dans ce qu’il fit, car il a laissé des traces multiples de sa présence, de ses faits et gestes dont il ne se souciait guère semble-t-il, mais dans la manière dont il le fit comme leur raison d’être. Le qu’en dira-t-on ne paraît certes pas avoir été sa préoccupation essentielle.
Le goût contemporain des société secrètes, cette transposition païenne du couvent qui guette tous ses textes libertins est aussi un dada chez lui ; ses thuriféraires inclinent à en imaginer à son sujet, qui auraient étendu leur action au-delà des boudoirs, mais nulle part ailleurs on ne semble en avoir trouvé trace, sinon dans la prolifération alors de ce genre de regroupements et sociétés d’opinions: naissance de la Franc-Maçonnerie et des clubs sous la probable influence anglo-saxonne par exemple.
Un Curriculum Vitae pour décrire un tel personnage était impossible : il me fallut un récit.
L’influence de « Félicia » au moins sur « Les Amours du Chevalier de Faublas » de Louvet de Couvray comme sur « Les liaisons dangereuses » n’a jamais été mise en doute ; les auteurs d’alors n’étaient d’ailleurs pas si farouches ou vaniteux qu’ils ne reconnussent leur dette.
Les rouages, les intrigues de ces ouvrages restent encore simples si la puissance du récit n’a plus de rapport. Que ce soit dans la compilation ou le tableau de mœurs, leurs auteurs ne se souciaient guère de dissimuler leurs recettes ou de s’habiller de doctrines. L’important n’était-il pas avant tout de faire vite et prestement, avec esprit et de frapper fort. Cela valait pour tout un chacun. Il fallait être Voltaire pour faire le glorieux ou les encyclopédistes de se prendre au sérieux de leurs raisons politiques et sociales : ceux-là croyaient à ce qu’ils faisaient. Un auteur sinon ne réclamait pas grand ’chose pour son compte, semblait peu s’en préoccuper, c’eût été de mauvais goût ; il feignait presque la surprise si l’on s’intéressait à lui. Vivant Denon en agissait encore de même en plein XIXe au sujet de « Point de lendemain » écrit alors avec l’idée d’un divertissement rétrospectif.
Pas davantage chez Nerciat que chez les autres, pourtant si curieux à titre personnel et amateur d’horizons ne s’inscrit dans la quête libertine « à la française » de nostalgie d’exotisme ni de voluptés orientales, de harems ou d’odalisques aux courbes enchanteresses. Galland avait pourtant donné une version des « Mille et une nuits » dès le début du siècle, mais elle n’avait pas apparemment apporté encore les rêveries opiacées peut-être auxquelles les Romantiques allaient donner tant d’ampleur ; les substances mystérieuses et vertigineuses étaient de purs et simples aphrodisiaques ; seuls quelques exportés pittoresques font figure de pages dans les lieux canaille et des Milords anglais opulents en général et par définition croirait on jouent les « deus ex machina ».
Afin de justifier leurs intrigues, les auteurs libertins avaient jusque-là consenti à leurs héros des capacités érotiques à toute épreuve : il le fallait bien sous peine de multiplier les « silhouettes », ce qu’ils faisaient bien assez, on les abandonnera discrètement peu à peu : on ne croit plus guère aux surhommes de nos jours.
Ainsi les mœurs, le goût, les sociétés, les modes, la mode évoluent-ils, les Révolutions les y ont bien aidés, il faut le dire : les romans eux aussi, avec la vie comme elle est ou comme on la rêve ou de connivence avec elle, avec la simple volonté de la décrire à la lointaine suite peut-être de ce que firent, rêvèrent et contèrent les Romantiques, qu’ils inscrirent dans la littérature et lui dictèrent ?
Les romjans avant eux étaient en priorité récits d’une existence plus ou moins imaginaire, ou d’une crise qui intervenait, bien plutôt qu’inventaires d’états d’âme. Ou description et étude d’un milieu social bien précis qui, ce qui n’est pas surprenant, s’empresse de « dater » et se démode plus vite qu’à son tour. Si l’auteur de jadis ne réclamait pas grand’chose pour son compte, bien vite il n’en fut plus de même.
Roman ou pas ? Qui s’en souciait ? L’appellation de romancier était-elle si importante alors ou visait-elle simplement à se dispenser des contingences du réel ?
Quelques esprits frondeurs, certains se nommant même libertins dans un XVIIIe siècle accueillant et propice, avaient vite fait ricochet, et ceci de plus en plus fort à mesure que la Révolution s’approchait.
En 1782 puis en 1787-1789 ainsi successivement ces « Liaisons dangereuses » de Laclos puis « Les Amours du Chevalier de Faublas » de Louvet de Couvray qui se rattachent nettement à cette littérature libertine tout en se dégageant de la pure licence, mais en lâchant encore dans la société des personnages qui en relevaient directement.
Ici encore ici surtout les auteurs de ces deux ouvrages, d’une authentique jeunesse eux-mêmes, méritent le détour et m’interdisent de les laisser de côté, d’autant qu’ils vont éclairer ma route : ce ne sont pas des gens de lettres, faut-il le noter.
Laclos relève aussi de ce fond de littérature dépravée au moins dans son inspiration et son intrigue et les progrès qu’elle enregistrait, bien que le retentissement de son chef d’œuvre, parfaitement justifié, ne soit d’un tout autre acabit que d’un second couteau ! Né à Amiens en 1741 il est militaire, jeune officier d’artillerie rempli d’ambition et d’idées stratégiques révolutionnaires en ce qui concernait son arme, notamment sur la valeur dans l’avenir des fortifications de Vauban, mal accueillies bien entendu. Plus ou moins en disponibilité, il « voulut faire un ouvrage qui sortît de la route ordinaire, fît du bruit et retentît encore sur la terre quand j’y aurais passé » dit-il bien plus tard, « interviewé ». On ne saurait mieux souligner son caractère concerté.
Les écrivains professionnels n’étaient pas légion alors, qui se bousculeront bientôt au portillon… Henriot parlera plus loin du roman dit psychologique inauguré par madame de La Fayette continué par Laclos, Constant et Stendhal. En est-il d’autre ? Les romans picaresques, les romanciers français en général se préoccupent plus volontiers d’amour que d’autre chose (Manon Lescaut) à la différence peut-être de leurs confrères de langue anglaise, autres principaux spécialistes. Et que n’aient pas broyés la mode et le temps qui passe, les inévitables meules de la postérité. Laclos était un esprit supérieur et un ambitieux, mais son destin lui interdira de se déployer dans les cyclones de la Révolution et de l’Empire : après avoir été l’âme damnée du Duc d’Orléans puis rejoint les Jacobins, il échappa de très peu à la guillotine (peut-être ménagé par Robespierre), il rejoignit Bonaparte qui le fit général et mourut avant d’avoir pu montrer toute sa mesure. Au fait, sa vie privée fut tout au long irréprochable, sa correspondance en fait foi.
Plus jeune, Louvet de Couvray naquit en 1760, fit paraître « Les Amours du Chevalier de Faublas » en 1787 et 1789, ouvrage fort libertin, mais nullement pornographique, et qui connut un grand succès. Très républicain, il fonda un journal influent, « La Sentinelle », devint député à la Convention où il se montra orateur brillant et un leader des Girondins. Adversaire résolu de Robespierre, il réussit à s’enfuir et à se cacher dans le Jura pendant la Terreur, jusqu’au 9 Thermidor, mais il mourut peu après, en 1797.
Son héros Faublas est un jeune fou qui se calme peu à peu dans le second volume du livre au fur et à mesure que la vie et la société lui montrent leur vérité, leur dureté et qu’il en prend conscience ; les protagonistes complices des Liaisons pour leur part, qui trouvèrent eux aussi leur modèle dans des livres graveleux, mais se gardent bien d’en faire état sauf l’un vis-à-vis de l’autre et en sont d’autant plus dangereux et malfaisants, menant dans le secret, sans vaciller ( sauf Valmont, attendri un bref moment) la danse jusqu’à l’impitoyable catastrophe finale, un véritable jugement dernier.
Simplement peut-on relever là le caractère achevé et concerté de la séduction qui relève du système et l’intègre, mais ne procède plus guère de ces rencontres, de ces impromptus vaudevillesques et « boulevardiers » chers aux auteurs proprement libertins qui contribuent à leur charme, mais les confine dans leur rôle.
Chez Laclos les perfides séducteurs choisissent délibérément, sélectionnent presque leurs victimes parmi les plus difficiles à « corrompre » apparemment afin de constater la perfection de leur technique et leur propre génie.
Ces jeunes ambitieux peuvent-ils faire transition ?
En effet il s’agit là d’un pur sadisme, et qui serait intelligent de surcroît puisque la Marquise de Merteuil, blasée, finalement ne se voudrait plus voir que comme telle. Cette construction relève en tout point du roman tel qu’il allait s’inventer ? Il est peu encore de substance proprement romanesque chez eux, sinon dans leur secret et leur dissimulation, le hasard, la péripétie relèvent du théâtre davantage que de la vie vécue.
Ils ne se mêlaient guère de psychologie si ce n’est pour en armer la turpitude de leurs acteurs ou décrire la candeur de leurs proies et la faiblesse de leurs armes défensives.
Néanmoins peut-on relever la croissance du cynisme, de la brutalité, de cette violence et de la méchanceté qui s’embarqueront dorénavant sur l’Arche de Noé humaine.
Voici, me semble-t-il, à sa vraie place, l’apparition, le lever progressif du soleil noir sado-sadien sur la légèreté du siècle.
Le divin Marquis est contemporain à peu près exact de Nerciat, né un an avant lui, en 1740, qui, encore traditionnel de fait, ne « fait » pas dans la psychologie, sinon pour « afficher » ses personnages.
Il ne se distingue pas au départ par ses textes ! Mais par les inculpations et les incarcérations qui ont plu sur lui dès 1763, brisant une éventuelle carrière au départ là encore dans l’armée et qui devait être pour lui une authentique vocation : il n’était pas un cadet de famille, mais d’ores et déjà un puissant seigneur qui avait pris la peine de naître. Avait-il écrit auparavant ? Il ne le semble pas : il développa surtout dans ses geôles successives sa philosophie rageuse et sa volonté de destruction d’une société qui l’empêchaient de se libérer à sa guise et les possibilités de ses chaînes, de ses obsessions.
Si libertinage il y a chez lui, c’est en tant que vengeance et l’arme des méchants ; sa libre furie symbolise leur triomphe, mais ce n’est nullement dans le simple climat jouisseur de son siècle qu’il cherche son encre. Si ses premiers écrits les 120 Journées de Sodome étaient un peu antérieurs à la Révolution, ils devront le jour à ses tempêtes (libéré, il devint président de la section des Piques) avant qu’il ne voie se refermer définitivement sur lui les portes des prisons ou des asiles. Il aura pu à bon escient métamorphoser en prisons les abbayes ou les châteaux écartés, décors enchantés de la paillardise antérieure.
S’il va vers les libertins, ce n’est plus à leur rencontre, mais à leur encontre et § abolissant, en détournant le cours du sort de la littérature grivoise d’alors, en ces finalement charmants contreforts de ce XVIIIe siècle, celui qui avait trouvé le secret de la douceur de vivre si l’on veut en croire Talleyrand, que lui, certes avait toutes les chances de savourer, mais dont se sont si bien accommodés Diderot, Voltaire et finalement Rousseau voire Restif qui aurait bien des facettes un peu chez tout le monde ! Pour ne pas parler de nombreux vivants tels que Casanova, le « Comte de Saint-Germain » ou le Maréchal de Richelieu, le Prince de Ligne ni de Vivant Denon dont le merveilleux « Point de lendemain » est une dentelle de libertinage au langage délié, mais dont la diffusion tardive viendra en temps voulu enjamber le siècle et inspirer Musset !
Il avait fallu être J.J. Rousseau pour en pleurnicher (si bien cependant !).
Dorénavant la révolution et Sade (celle-ci lui donnant d’ailleurs la possibilité de faire entendre sa voix) se seront emparés de la scène.